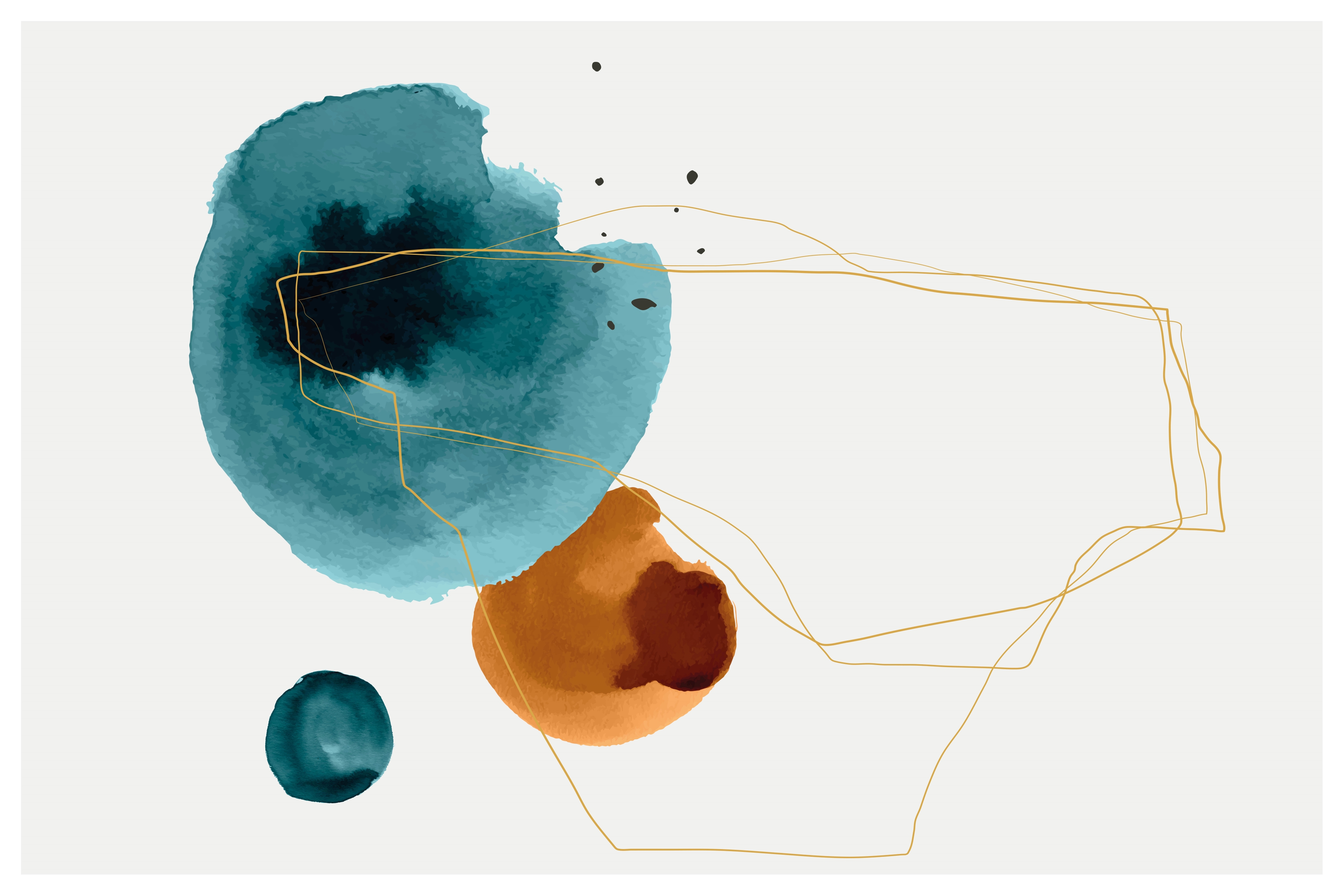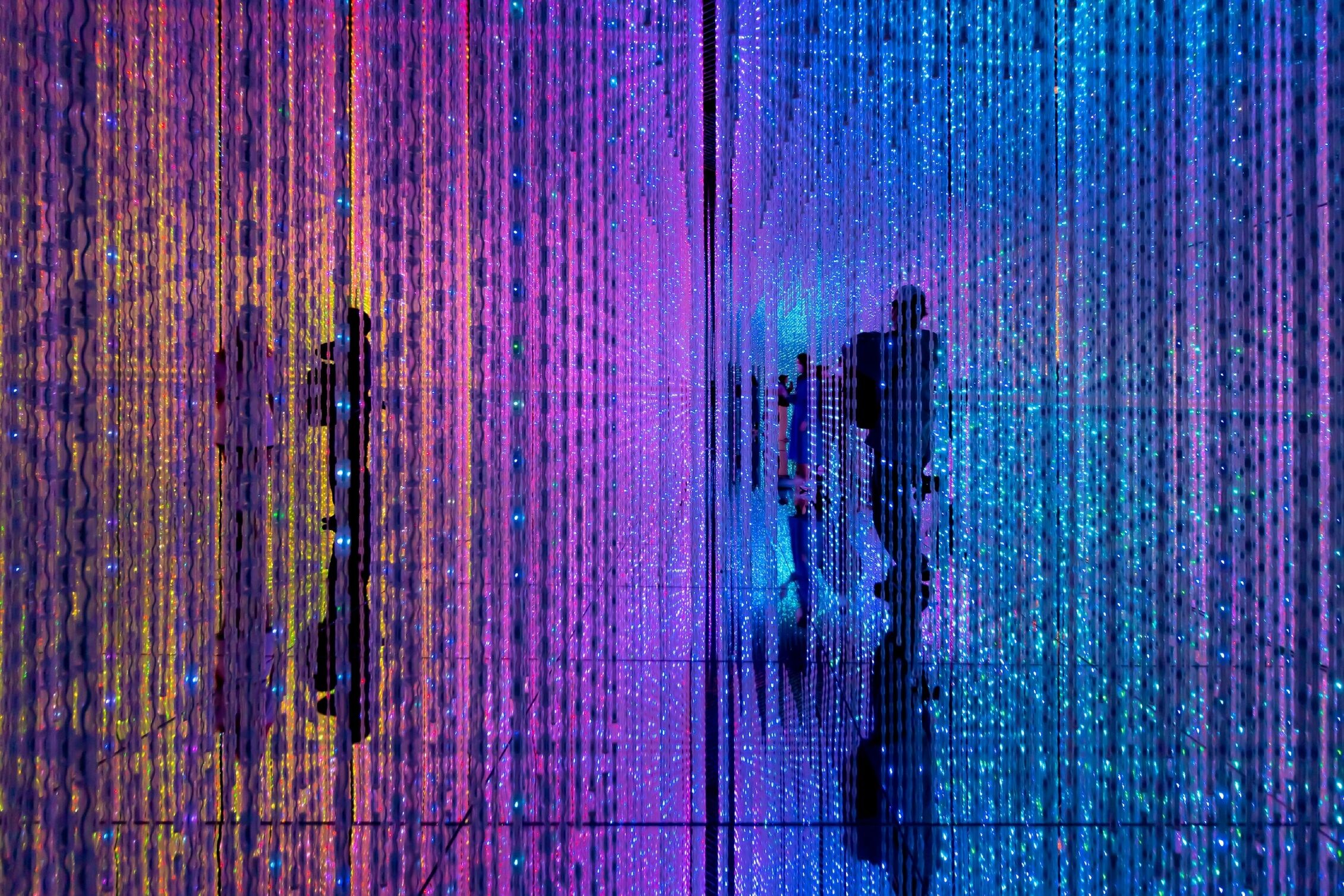EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
EY Sustainable Futures, édition 2024
Quels enjeux et clés de succès pour déployer les modèles d'affaires durables à grande échelle ? Décryptage de la 3ème édition de la soirée EY Sustainable Futures, qui rassemble chaque année scientifiques et leaders économiques pour accélérer la transformation durable des entreprises.
Prospectives & décryptage des enjeux de transformation durable

Au sein Muséum national d'Histoire naturelle, Dr. Ilham Kadri (Syensqo), Cléa Martinet (Renault Group), Jean-Philippe Puig (Avril), Hélène Valade (LVMH) partagent six leviers pour déployer leurs modèles d’affaires durables à grande échelle :
- L’inclusion de la durabilité dès la conception du produit.
- La mobilisation de toutes les strates de l’entreprise.
- L’indexation des modèles de rémunération sur les objectifs de durabilité.
- Une mesure de la performance facilitée par des outils de pilotage qui intègrent l'IA.
- Le soutien à la transformation durable des fournisseurs.
- Des coalitions pour accélérer la transformation de son écosystème.
Les chercheurs Gilles Bloch, Président du Muséum et François Gemenne, co-auteur du 6e rapport du GIEC, appellent les décideurs économiques à contribuer à un nouveau projet de société grâce à la force d’innovation dont seules sont capables les entreprises.
« Notre futur dépend de jusqu’où nous sommes prêts à nous transformer, dès maintenant », analyse Alexis Gazzo, Partner & Sustainability Leader EY.
Que commande l’urgence climatique aux entreprises ?
Alexis Gazzo
Associé, Climate Change & Sustainability leader, France
Accélérer le déploiement de modèles d’affaires durables est une réalité opérationnelle complexe à mettre en œuvre. Pour autant, les entreprises leaders ont su s’en saisir pour revoir en profondeur leur stratégie, leur gouvernance, le pilotage de leur performance et ainsi prendre un temps d’avance. Comment bâtir son plan de financement, décliner sa feuille de route, embarquer tous ses collaborateurs dans la transition écologique ? Notre événement annuel, « Sustainable Futures », dont la 3e édition s’est tenue au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, le 3 juin 2024, apporte des éléments de réponse.
La contrainte climatique se concrétise
52,3°. C’est la température affichée en Inde, enregistrée dans la banlieue de New Delhi, le 29 mai 2024. Une erreur de capteur de 3 degrés, selon le gouvernement indien. Cette nouvelle vague de chaleur a rendu la vie insupportable aux 33 millions d’habitants de la capitale, causant la mort de 33 agents électoraux le dernier jour des élections nationales.
Les récents confinements climatiques imposés par des vagues de chaleur dans des régions d’Inde ou d’Afrique illustrent la vie dans un monde sous contrainte climatique. Un écho au cri d’alarme de 380 scientifiques interrogés par « The Guardian », le 8 mai dernier. Près de 80 % d’entre eux estiment que le réchauffement climatique atteindra au moins 2,5° C par rapport à l’ère préindustrielle d’ici à la fin du siècle.
Les événements climatiques extrêmes n’épargnent pas l’hémisphère Nord : graves inondations dans le Pas-de-Calais au premier semestre 2024 ; feux de forêt au Canada – l’un des plus grands brasiers de l’été 2023 ; inondations en Allemagne en 2021, avec plus de 40 milliards d’euros de dégâts à la clé.
« Comme jamais dans l’histoire récente de l’humanité, la physique du climat nous relie les uns aux autres. Notre futur climatique dépend aussi du résultat des élections indiennes et des choix de cette nation en matière climatique et énergétique », indique François Gemenne, co-auteur du 6e rapport du GIEC. Et inversement…
Le changement climatique, c’est l’un des principaux facteurs de perte de biodiversité. Or plus de la moitié du PIB mondial, de nos systèmes économiques dépendent de la nature. La dégradation des écosystèmes met bel et bien en danger les conditions de vie sur Terre, tout comme la création de valeur. À peine commençons-nous à en prendre conscience !
30 % des espèces répertoriées et suivies – 160 000 à ce jour – sont menacées d’extinction. À l’instar des groupes d’oiseaux des milieux agricoles, en déclin de 57 % depuis le début des années 1980. « La phase d’extinction massive, nous y sommes », alerte Gilles Bloch, président du Muséum national d’Histoire naturelle. Par ailleurs, on identifie désormais cinq fois plus de virus par an potentiellement dangereux pour l’homme que voilà un siècle. Hélène Valade, directrice Développement Environnement du groupe LVMH, pour qui la biodiversité est un enjeu majeur, rappelle : « Pas de champagne sans raisin ; pas de cosmétiques sans fleurs ; pas de parfums sans espèces végétales ; pas de jolies robes sans coton…»
Ne serait-ce que pour répertorier un maximum d’espèces, il est urgent d’investir dans la recherche. Y compris du côté des entreprises, du secteur agro-alimentaire notamment. Pour Jean-Philippe Puig, directeur général d’Avril, « notre modèle économique – nos bénéfices ne sont pas distribués en dividendes mais réinvestis – permet d’investir à long terme dans la recherche et le développement de semences.
Actuellement, 80 % des lentilles et des pois chiche consommés en France sont importés, faute de recherche sur leur variété ».
Le point de bascule est en train d’être franchi
2000 milliards de dollars. Ce sont les montants qui devraient être investis dans les énergies décarbonées en 2024, selon l’Agence Internationale de l’Energie, soit 2 fois plus que dans les énergies fossiles.[AG1]
Le « business as usual » n’est plus une option aujourd’hui. Chaque jour, nous percevons les conséquences de l’inaction. Se dessinent deux types d’entreprises : celles qui anticipent et font évoluer en profondeur leur modèle, et celles qui ne font évoluer leurs pratiques qu’à la marge. Pourtant, la direction à prendre a été clarifiée par le législateur :
- La France s’est dotée, en 2023 également, d’une planification écologique – un plan d'action pour accélérer la transition écologique, par secteur d’activité.
- L’UE a adopté formellement le paquet « Fit for 55 » en octobre dernier, impliquant par exemple de faire passer la part des énergies renouvelables dans la production électrique de 44% en 2023 à plus de 70% en 2030. Exprimé en capacité installée, cela signifie pour le solaire passer de 200 GW de solaire installé à 600 GW en 2030.
- À l’échelle internationale, la COP28 s’est conclue en décembre 2023 par un consensus : la nécessité de sortir des énergies fossiles d’ici à 2050. Un défi à relever en vingt-cinq ans, autant dire demain ! Cela nécessite de passer à la vitesse supérieure dès maintenant, par exemple en triplant la capacité installée d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Pour y parvenir, il faudra aussi doubler a minima les financements en faveur des activités bas carbone. D’après l’Agence Internationale de l’Energie, sortir de notre dépendance aux énergies fossiles nécessitera des investissements compris entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars par an. C’est considérable, mais ce n’est jamais que 2 à 4 % de la capitalisation boursière mondiale.
D’une ampleur inédite, cette transition nécessite un effort à ne pas sous-estimer, tout comme les difficultés qu’implique un tel changement d’échelle : tensions sur les ressources, conflits d’usages, compétences à mobiliser….
Certes, on entend parler de désillusion, de ralentissement, voire de pause à propos de la transition écologique. Mais gardons à l’esprit que notre économie se transforme en profondeur. De manière irréversible. Un constat factuel, étayé par des données macro-économiques. En 2023, plus de 80 % des nouvelles capacités électriques installées sont renouvelables. Une voiture sur cinq vendue dans le monde est électrique. Les filières de la transition énergétique concentrent plus d’investissements et emploient davantage de personnes que le secteur des hydrocarbures. Autant d’exemples de la transition en cours.
Pour les entreprises leaders, le climat et la durabilité ne sont plus une variable d’ajustement
13 000. C’est le nombre de collaborateurs qu’a embarqué Ilham Kadri, PDG de Syensqo – émanation de Solvay créée en 2023 –, dans une transition écologique. Objectif : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040, tout en renforçant la rentabilité du Groupe. Cette chimiste de formation croit en l’apport de sa discipline dans le développement de solutions durables : « Sans chimie : pas de batterie, pas de soins, pas d’eau propre et pas de connectivité ! ».
Pour les entreprises leaders de leur secteur, les sujets climat et durabilité – pleinement intégrés à la stratégie et au pilotage opérationnel –, ne sont plus une variable d’ajustement. Trois critères les caractérisent aujourd’hui, selon les intervenants à « Sustainable Futures » :
- La transversalité : faire évoluer la gouvernance est une nécessité pour faire travailler, ensemble, les fonctions et compétences nécessaires à la transformation et pour embarquer toutes les strates de l’entreprise.
- Le caractère opérationnel : pour nombre d’entreprises, l’enjeu n’est plus tant de gagner la bataille de la conviction en interne que de définir un plan de financement – à défaut, un plan de transition est un vœu pieux – et d’exécuter la feuille de route.
- La complexité : la biodiversité est un bon exemple de la technicité des questions que traitent les entreprises aujourd’hui. Comment mesurer son impact sur la biodiversité ? Comment se fixer un objectif en cohérence avec les engagements du Global Biodiversity Framework issus de la COP15 ? Quelles métriques utiliser ? Comment se transformer pour tendre vers des modèles résilients, des modèles régénératifs ?
Une interdépendance soulignée par Cléa Martinet, VP Sustainability de Renault Group : « Nous, constructeurs automobiles, sortons de l’ère de l’autosuffisance. Nous ne vivons plus en autarcie avec nos fournisseurs. Nous avons besoin d’un écosystème dense pour avancer. De chimistes pour nous aider à concevoir nos batteries et à les recycler. Autour d’un même objectif, nous constituons désormais des coalitions ».
Outiller toutes les strates de l’entreprise pour changer d’échelle
4 000. C’est le nombre de collaborateurs mobilisés sur la sustainability par EY à travers le monde.
Nouveaux processus, collaboration entre fonctions, accès et manipulation des données nécessaires, gestion de compétences, conformité… C’est souvent lors du passage à l’action que les entreprises prennent la mesure de la complexité d’un plan de transition. Pour nombre d’entre elles, l’actualité est de rendre opérationnels les plans d’action définis, de trouver les financements. Comment aider nos clients à
anticiper les conséquences du changement climatique et de la perte de biodiversité, à construire des plans de transformations ambitieux ? Nous sommes convaincus de la nécessité de mobiliser de nouveaux outils – en s’appuyant sur l’IA – et de travailler davantage en écosystème.
Autour d’une équipe de spécialistes, EY s’investit dans la transition écologique et climatique depuis plus de vingt-cinq ans. En France, ce sont plus de 300 personnes qui travaillent sur la question – plus de 1 000 en Europe et plus de 4 000 personnes à travers le monde. Depuis quelques années, nous renforçons nos investissements dans le digital en développant de nouveaux outils : analyse du risque climat (« EY CAP »), risque biodiversité (« EY NAT »), pilotage de la performance RSE.
Dans cet esprit, nous avons ouvert en septembre 2023 notre ImpACT Lab : un lieu dédié à la transformation durable, dotée d’une salle immersive qui plonge le participant dans le Paris de 2043. Caniculaire. L’objectif : visualiser des futurs possibles – « On ne croit que ce qu’on voit » –, et s’en servir pour se mettre en mouvement, passer au plan d’action. Avec une conviction : nous pouvons inverser la courbe de nos émissions – notre futur dépend de jusqu’où nous sommes prêts à nous transformer dès maintenant. L’alternative ? Se résigner à vivre dans un monde sous contrainte climatique, économique, sociale…
Revivez les temps forts de la soirée en images